|
Newsletter |
Keep yourself updated with our FREE newsletters now!
|
|
|
|
|
Home  Transcontinental Transcontinental  Pourquoi l’Europe est-elle absente du Moyen-Orient ? Pourquoi l’Europe est-elle absente du Moyen-Orient ?

|
Pourquoi l’Europe est-elle absente du Moyen-Orient ? |

|

|

|
|
Written by Mohamed Abdel Azim
|
|
Monday, 08 January 2007 |
|
Depuis
plusieurs années, l’Europe n’arrive pas à se positionner par rapport à
la ligne américaine et trouver sa marque dans les grandes questions
internationales. Le rôle de l’Europe se limite jusqu’à présent à une
aide économique sans vraiment peser dans la balance des décisions
concernant le Moyen-Orient depuis la crise de Suez en 1956.
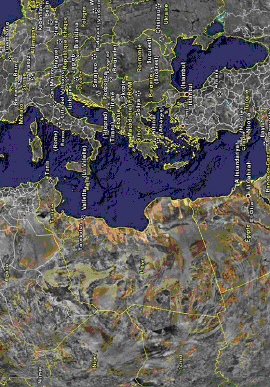 À
la fin de l’année 2002, lorsque George W. Bush brandit la menace de
Saddam Hussein, il évoque le danger que le monde en général et les
Etats-Unis en particulier encourent devant la menace théorique des
armes nucléaires irakiennes. Au même moment, la Corée du Nord se
déclare en phase finale de la production de sa première bombe atomique.
Les efforts de l’Europe sont alors voués à l’échec pour éviter le
déclenchement de la guerre en 2003. Depuis cette
date, l’invasion de l’Irak a lieu et la chute du régime de Saddam
Hussein est intervenue. L’Europe a alors assisté impuissante devant le
procès de figuration contre le dictateur de Bagdad qui se termine par
son exécution. La guerre en Irak fait un écran durant trois ans et
permet au régime de Kim Jung-Il de passer à l’essai nucléaire en
octobre 2006, et à l’Iran d’accélérer son programme d’enrichissement de
l’uranium. L’essai nord coréen dévoile la fragilité de la politique
américaine contre la prolifération et met en évidence une fissure
idéologique entre Washington d’un côté et la Chine et la Russie de
l’autre. L’Europe quant à elle, peine à formuler une résolution de
sanctions contre Téhéran et on arrive, en fin de course et après des
difficiles négociations, à une résolution à la carte pour satisfaire
Moscou et Pékin. L’avancée américaine d’abord en
Afghanistan, puis en Irak et la mise en ligne de mire de l’Iran aboutit
à une situation marquée par une méfiance chinoise et russe. On assiste
alors à l’absence d’une cohérence américaine dans la gestion des
dossiers majeurs. La résolution des crises passe par les actions de
conflits armés. George W. Bush est l’homme de deux guerres. Après la
guerre en Afghanistan et celle en Irak, son administration reste prête
à entamer une autre contre l’Iran. Le manque de
cohérence américaine aboutit à l’adoption de résolutions avec des
sanctions à la carte contre Pyongyang et contre Téhéran. Après l’Irak
et le déclenchement de la guerre sur des bases fictives et des armes de
destruction massive inexistantes, Washington a du mal a convaincre
Moscou et Pékin du bien fondé d’une résolution imposant des sanctions
économiques fortes pour faire plier l’Iran. Depuis l’essai nord-coréen
les Européens n’arrivent pas à persuader Téhéran à abandonner son
programme nucléaire. L’effort européen pour stopper le programme
d’enrichissement de l’uranium de l’Iran est alors neutralisé et Téhéran
risque de se retirer du TNP (traité de non-prolifération nucléaire). Il
y a toutes les raisons d’une forte crainte d’explosion totale et sans
précédente de la situation au Moyen-Orient. Ce scénario cauchemar
plongera toute la région dans un chaos permanent et généralisé. Contrairement
à l’Europe, l’Amérique manque de cohérence dans son action au
Moyen-Orient. Washington présente des lacunes dans sa compréhension de
la particularité régionale. Les Etats-Unis voient les choses en noir et
blanc alors qu’il y a des nuances et même de toutes les couleurs. Avec
une vision schématique, les Etats-Unis oscillent entre fermeté et
hésitation. Ils opèrent sur une échelle à trois niveaux. Sur les deux
extrémités de cette échelle, on trouve l’usage de la force d’un côté et
la difficulté de l’action de l’autre. Dans le nouvel environnement
moyen-oriental, Washington navigue entre trois scénarios graduels.
D’abord le scénario sans appel de va-t-en guerre (Afghanistan et Irak),
puis le scénario diplomatique assorti de sanctions à la carte (le cas
nord coréen) et enfin le scénario de l’incapacité d’action pour arrêter
un programme nucléaire d’un pays techniquement capable et politiquement
déterminé (le dilemme iranien). Face à ce dilemme,
Washington navigue à l’estime. La politique américaine peut être
comparée à un navire, avec Washington comme capitaine qui navigue dans
une zone dangereuse mais n’utilise plus les procédés de guidage
perfectionnés. Ces procédés, qui aident à éviter les obstacles, ne lui
servent plus car il a adopté un ligne droite. Bref, dans la linéarité
de Washington, l'électronique ne peut plus remplir ses fonctions. La
partie vitale, celle qui contient le système de communication, mue par
l'électronique (comme celui de la CIA), est volontairement mise en
veille par le capitaine George Bush. Après Rumsfeld et
Bolton, le remplacement de John Negroponte, à la tête des
renseignements américains, par John McConnell en est l’exemple. Dans le
domaine de la relation internationale, la linéarité washingtonienne
aboutit à des scénarios incalculables car elle ne tient pas compte des
effets du jeu d’interaction dans lequel rien ne peut être calculé à
l’avance.. Cette linéarité voit du nucléaire là où il n’y en a pas et
mène la guerre en Irak. Cette même linéarité traîne le pas envers le
nucléaire là où il est supposé être et prône le diplomatie envers
Pyongyang. Enfin cette linéarité, en raison du cas irakien et nord
coréen, perd de la vitesse diplomatique et de la crédibilité d’action
face au programme nucléaire iranien. Le président français Jacques
Chirac va même jusqu’à qualifier, le 5 janvier, l’invasion américaine
en Irak d’“aventure”. L’Europe a encore un rôle à jouer avant que cette
vieille Europe ne soit définitivement assimilée aux actions d’une
administration qui ne voit pas et qui présente des symptômes de surdité
en terme de politique étrangère.
Mohamed Abdel Azim*
Lyon (France)
__________________________________________________________________________ * Mohamed
Abdel Azim est docteur en Science politique. Journaliste à EuroNews, il
est l’auteur du livre : Israël et la bombe atomique, la ace cachée
de la politique américaine, Paris l’Harmattan, 2006.
|
|
 Romania's first gift to the EU: a caucus of neo-fascists and Holocaust deniers... Romania's first gift to the EU: a caucus of neo-fascists and Holocaust deniers...
"We've already got a common programme" told the far-right Austrian MEP Andreas Moelzer ... (Guardian 08/01)
The
accession of Romania and Bulgaria, ironically has made the caucus
possible: representatives from at least five countries, and a minimum
of 19 MEPs. The far right parties in Europe now meet this requirement,
including MEPs like among the younger ones, Bruno Gollnisch
(deputy leader of Mr Le Pen's National Front), Alessandra Mussolini,
Corneliu Vadim Tudor, who runs the anti-Hungarian, anti-semitic and
anti-Roma Greater Romanian party, Volen Siderov from Ataka party, Mr
Moelzer (former ideologist for Mr Haider), Frank Vanhecke, the leader
of Vlaams Belang, members of the League of Polish Families, UK
Independence party ... about 20 to 40 MEPs from at
least six countries... A pretty nice family these post-modern
great grand sons (white-collar, mobile phone, Internet) of Hitler,
Franco, Mussolini and Petain who are taking Europe of the
Fatherlands in the hands and take control of the EU with the complicity
of a European machinery turned into a bureaucracy ...
"Antidemocratic
and xenophobic forces of Europe have always been attracted by the
European unity dream, mystic of the imperial Rome" - Franck Biancheri (in 1998): Europe in 2009, could end up in the hands of the post modern great grand sons of Hitler, Franco, Mussolini and Petain |
|
|
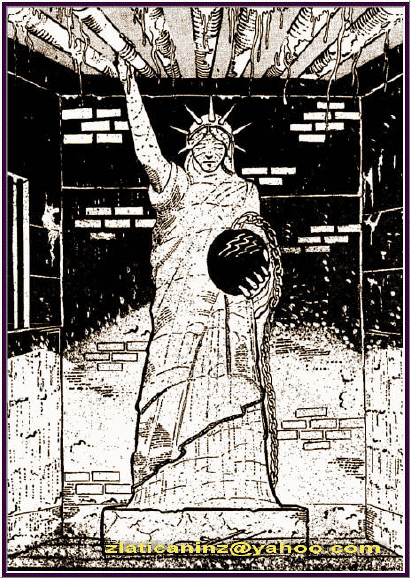





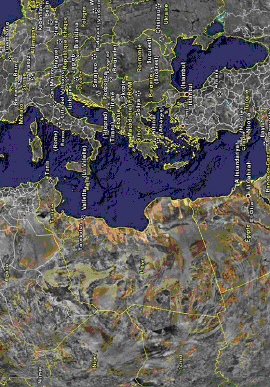 À
la fin de l’année 2002, lorsque George W. Bush brandit la menace de
Saddam Hussein, il évoque le danger que le monde en général et les
Etats-Unis en particulier encourent devant la menace théorique des
armes nucléaires irakiennes. Au même moment, la Corée du Nord se
déclare en phase finale de la production de sa première bombe atomique.
Les efforts de l’Europe sont alors voués à l’échec pour éviter le
déclenchement de la guerre en 2003.
À
la fin de l’année 2002, lorsque George W. Bush brandit la menace de
Saddam Hussein, il évoque le danger que le monde en général et les
Etats-Unis en particulier encourent devant la menace théorique des
armes nucléaires irakiennes. Au même moment, la Corée du Nord se
déclare en phase finale de la production de sa première bombe atomique.
Les efforts de l’Europe sont alors voués à l’échec pour éviter le
déclenchement de la guerre en 2003.










 Romania's first gift to the EU: a caucus of neo-fascists and Holocaust deniers...
Romania's first gift to the EU: a caucus of neo-fascists and Holocaust deniers...